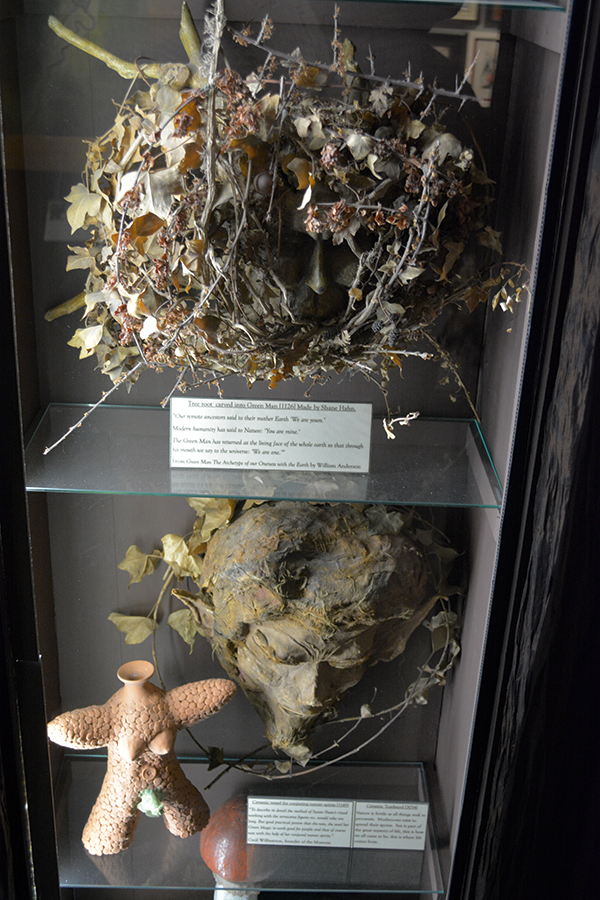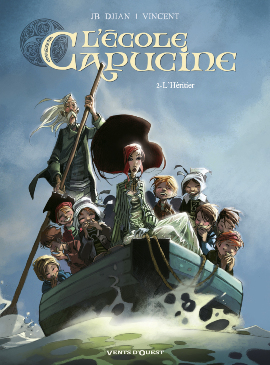Présentes dans les légendes germaniques, associées au culte de Diane, les sorcières sont autant de femmes se transformant la nuit en oiseaux de proie, pénétrant dans les maisons pour y dévorer les enfants. Mais les sorcières ne sont pas nées uniquement de par ce passé légendaire. Elles ont véritablement pris naissance dans le climat très particulier du XVe siècle. En voulant théoriser la chasse aux hérétiques, quelques textes mirent en place une véritable démonologie qui allait renforcer l’imagination populaire. C’est cette officialisation de l’existence des sorcières qui va aboutir à la furie des bûchers et autres pendaisons qui auront cours entre le XVe et le XVIIe siècles. Mélangeons cette fièvre inquisitoire, les croyances populaires et ajoutons à cela quelques épidémies, famines, maladies inexpliquées… et nous arrivons à cerner comment sont nées les sorcières. Victimes idéales pour figurer tous les malheurs du monde.
Le Malleus Maleficarum …
Le Pape Innocent VIII donna, le 5 décembre 1484, un pouvoir très étendu aux deux inquisiteurs Jacques Sprenger et Henry Institoris. C’était la première fois que l’Eglise légiférait sur la sorcellerie. La bulle désignait les sorciers et sorcières non seulement comme hérétiques, puisqu’ils avaient renié la foi catholique, mais comme des agitateurs du Malin, des représentants du Mal. C’est dans la suite de cette bulle que les deux inquisiteurs rédigèrent le fameux Malleus Maleficarum (Le Marteau des Sorcières). Ce texte était destiné aux inquisiteurs et donnait, en quelque sorte, le mode d’emploi de la lutte contre les sorcières. Il différait de tous les autres écrits précédents, en ce sens qu’il n’avait pour sujet que le délit de sorcellerie.

La chasse aux sorcières…
Depuis 1252, la pratique de la torture pour faire avouer les hérétiques était de mise. Bien que la première forme de l’Inquisition disparut au XVe siècle, sa pratique survécut tout au long des siècles suivants, passant de la main cléricale à celle laïque et d’Etat. A la fin du XVe siècle, les vengeances et rancoeurs personnelles vont, chez les nobles comme chez les paysans, donner lieu à l’exécution d’innocents. Et lorsque quelqu’un se voyait accusé de sorcellerie, une fois la procédure entamée, il ne s’en sortait que pendu ou brûlé. Pour dénicher la sorcière, le bourreau essayait de trouver sa marque maléfique. Une marque réputée indolore. Dès lors, la pratique consistait à enfoncer des aiguilles dans le corps jusqu’à déceler l’endroit insensible…
La fin des sorcières
Jean-Baptiste Colbert fut l’un des premiers à souligner la nécessité de réformer le code pénal français. Dans la lignée de cette réforme, qui aboutit à la grande ordonnance de procédure criminelle (1670), on peut voir l’absence de remarques concernant le crime de sorcellerie. Nulle part, le nouveau texte n’en fait mention. Au début des années 1670, les chasses aux sorcières ne reçoivent plus d’appui judiciaire de l’appareil d’Etat. Restent les justices locales qui continuent, ci et là, de manifester un intérêt envers le crime de sorcellerie. Enfin, en 1682, un édit sur les magiciens, les devins et les empoisonneurs vient mettre un peu d’ordre dans les pratiques. L’édit stipulait que des preuves matérielles devaient être apportées de la culpabilité des accusés. Fini le temps où deux accusations suffisaient à faire pendre la malheureuse victime. Avec raison, la sorcellerie tomba peu à peu dans le domaine de la superstition.
Au XVIIIe siècle, c’est le mouvement artistique romantique qui fit reparler de sorcières mais, ici, plus de bûchers mais des tableaux, des contes, des romans, des musiques… Une vision différente aussi de la Sorcière. De vieille et laide, elle apparaît parfois jeune et belle. Enveloppée dans l’attirance envers le Mystère et la Nature, le mouvement romantique – et plus tard les mouvements gothique et fantastique – vont reprendre le thème de la Sorcière pour en faire le symbole du mystère, de l’inconnu, du secret et de la femme… Retenons les noms de Michelet, Goya, Nerval, Berlioz …
De la marque au sabbat
Les traditions populaires veulent qu’une sorcière soit initiée par le diable lui-même. Profitant de la faiblesse momentanée d’un pauvre être, Satan proposait un pacte alléchant: des pouvoirs terribles contre un serment d’allégeance. La “victime” ne pouvait résister à l’offre du sombre seigneur, que celui-ci flatte la vanité, profite du désespoir ou use de mille ruses, le pacte était scellé. Le diable promettait à une jeune femme nourriture et aisance si elle voulait bien se “marier” avec lui. Celle-ci, le plus souvent dans le besoin, acceptait de passer un pacte. S’ensuivait alors une messe “à l’envers” (puisque l’on se représentait le Mal comme l’envers du Bien) et bien entendu l’étreinte avec le diable.
Contrairement à ce que pense la majorité des gens aujourd’hui, cette étreinte était ressentie comme douloureuse par les sorcières. Une sorcière après l’initiation était marquée. Cette marque était réputée un endroit insensible à la douleur, quelque part sur le corps, bien souvent à l’épaule, ou encore se signalait par un changement de la couleur des yeux.
Le Sabbat se déroulait généralement la nuit. Convoqués par le diable, les sorciers et sorcières s’y rendaient à pied, en volant dans les airs grâce à un onguent dont ils s’étaient enduits le corps ou encore sur leur très célèbre balai magique… Les nuits du sabbat se déroulaient le plus souvent le vendredi ou à des dates fixes: solstices, équinoxes, 2 février, 30 avril, 2 août et 31 octobre. Elles avaient lieu en des endroits variables; par exemple, dans des clairières, au sommet des collines ou encore dans des prairies isolées le long d’une rivière. Ces endroits, le lendemain du sabbat, étaient facilement reconnaissables : l’herbe y était piétinée et, quelle que soit la saison, elle ne repoussait plus.
La Sorcière dans le folklore…
Partout en Europe, on peut entendre de nos jours le ricanement des sorcières. Que ce soit pendant les fêtes d’Halloween, en Angleterre, ou lors de la nuit de Walpurgis, en Allemagne, autour du Brocken, les sorcières sont fortement ancrées dans les imaginaires. Aux États-Unis, la ville de Salem est connue pour avoir été le siège du procès et de l’exécution de trois femmes en 1692. La police locale porte même un écusson représentant une sorcière ! Toujours aux Etats-Unis, les sorcières tenant boutiques et commerces, possèdent même leur propre journal : The Green Egg !
La Belgique fut témoin de nombreux bûchers. Aujourd’hui, le Folklore s’est emparé de ce sombre souvenir pour le transformer en une fête joyeuse. Ainsi des régions comme le Pays des Collines, la Basse-Meuse, le Plateau des Hautes- Fagnes… voient chaque année leurs campagnes envahies par d’étranges cortèges. Citons celui de Vielsam et de ses célèbres Macrâles ou encore le sabbat sur le Mareû aux Chorchîles (Marais des Sorcières) d’Ellezelles.
La France est également connue pour ses histoires de sorcellerie. Le Pays basque, la Creuse et le Cher sont des régions de prédilection pour les rassemblements sabbatiques. La France possède même un très beau musée axé sur le thème de la Sorcellerie.
Situé près d’Orléans, à La Jonchère Concressault, le musée propose à ses visiteurs de découvrir l’univers de la sorcellerie dans un bâtiment de 1200 m2 datant de 1836.
Séverine Stiévenart et Christophe Van De Ponseele
Article paru dans Khimaira Magazine N°2, avril 2005.
Femme et sorcière
La femme fut longtemps considérée comme marquée par le péché originel, c’est d’elle que provient toute l’origine du Mal. Sa physiologie, très mal connue, laissait libre cours à la plus folle des imaginations. Le contexte social était également en défaveur de la femme, son statut était dévalorisé. Ajoutons que les guerres enlevaient leurs maris, si ce n’était pas la mort naturelle. Or être veuf, dans la société médiévale, n’était pas une sinécure. Bien souvent, les veuves s’éloignaient de la vie communautaire et leur éloignement devenait prétexte aux rumeurs et aux légendes. Vient enfin la tradition du secret de certaines plantes médicinales que se transmettaient les générations de femmes. Secrets qui se transformèrent en magie noire lors des chasses aux sorcières.

J’aime ça :
J’aime chargement…